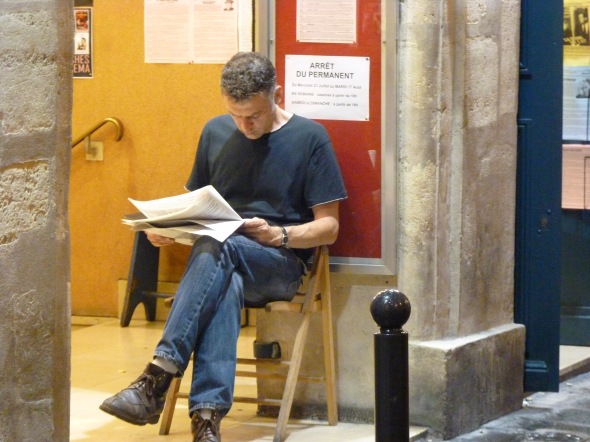Aïcha
Lundi 12 mars 2012
L’Algérie d’Hélène Cixous est aussi incarnée par une femme, Aïcha, la domestique de la maison.
– Mais qu’est-ce que ça veut dire connaître – dis-je – l’Algérie, à côté de mon frère, en suivant son silence exactement. Ce qui ne rappelle pas rappelle, dis-je et ne-pas-connaître l’Algérie c’est la connaître aussi. D’un côté j’ai entendu parler de l’Algérie dis-je, et j’en entends parler aujourd’hui encore par milliers, il y a des millions d’Algéries, il y a aussi des centaines de milliers de Villes d’Oran, et chaque Ville par centaines de milliers et des centaines de milliers de façons d’en entendre parler. D’un autre côté j’ai entendu parler l’Algérie, dis-je, mais si peu un filet d’eau pour mon désert.
– D’où ? demande-t-il, mon frère.
– Du fond du jardin surtout en la personne d’Aïcha, car c’est la seule Algérie que j’aie jamais pu toucher frotter retoucher tâter palper arquer mon dos à son mollet fourrer ma bouche entre ses seins ramper sur ses pentes épicées. Je me niche contre Aïcha depuis ses genoux et je regarde ses dents être la blancheur dans le rouge de sa bouche. J’étais sur elle, dis-je. Mais je n’ai jamais été chez elle. Je la comptais, j’ai compté ses dents, ses orteils au henné, ses enfants qui sortaient d’elle une nouvelle fois par an j’ai récité les noms qui sortaient d’elle Allaoua Baya Zouina Leila Ali plus vite Allaouabayazouinaleilaaïcha.
Je l’ai regardée. Je la regarde arriver à la voile au petit port de la cuisine, portée lente ample sans remuer par l’eau invisible avec la lourde légèreté de la barque de pêche qui s’échoue au sable en soupirant elle avance sans remuer les pieds petite majesté enveloppée jusque dans la petite cour. Je la regarde enlever le voile qui la berce et la barque parmi les barques blanches et dessous c’est une femme qui est-la-femme et il n’y a pas d’autre femme qu’Aïcha, ni ma mère ni Omi n’étant des femmes, ma mère une jeune fille sur un jeune garçon, Omi une dame d’Osnabrück venue d’une famille de photos distinguée, il n’y a pas de femme chez nous c’est pourquoi j’attends pour femme quotidienne le mûrissement du fruit venu tous les matins de la Ville d’Alger (…) Mais là-dessus m’arrive Aïcha lente crémeuse une jatte de lait sur le point de bouillir qui ne déborde pas remue de l’intérieur des épaisseurs désirables une gélatine enivrante à contempler pour son légérissime frémissement. M’arrive à moi en glissant sur l’eau brillante dont je déroule le trajectile depuis le portail jusqu’à la cuisine pour la regarder venir sans hâte sa course l’Aïcha que d’un cœur ferme je toue jusqu’au rivage de la cuisine et de la porte-fenêtre de ma chambre en tirant sur la corde. (…)
Ce qu’il reste de « Aïcha » qui est morte depuis longtemps : des volumes et des volumes. L’art. « L’Algérie », en tant que nom caressant de l’intouchable. Le nom velouté de la fuyance. La beauté du mou, beauté rare et difficile. Les grands seins mous mal accrochés à la corde exprès, ce qui leur donne une autonomie à chacun. Les ronds des yeux entièrement marrons mouillés luisants comme des lunes brunes contournées au khôl. Les pâtisseries de chair, un air de pièce montée qui m’allèche encore, et c’est le montage qui bouleverse, la multiplication des parties semblables de la poupée pour laquelle j’aurais vendu mon âme, l’interminable nombre d’elles qui la compose.
Hélène Cixous, Les rêveries de la femme sauvage : scènes primitives, Galilée, p. 89-92
Portrait d’une rencontre, 2
Vendredi 6 janvier 2012
Une autre rencontre, toujours chez Emmanuel Carrère, toujours autour de Juliette. Celle de son ami le juge boiteux, Étienne, qui la raconte au narrateur et qui lui livre, sans détour, son propre portrait de la femme énergique et combative, de la collègue douée, de l’amie disparue. Et des cadeaux simples et immenses qu’ils se sont faits en travaillant ensemble.
Une chose fait rire Étienne quand il raconte sa rencontre avec Juliette. Ce sont les mots qui lui ont traversé l’esprit la première fois qu’il l’a vue. On a frappé à la porte de son bureau, il a dit : oui, entrez, et quant il a levé les yeux elle s’avançait vers lui sur ses béquilles. Alors il a pensé : chouette ! Une boiteuse.
Ce n’est pas d’avoir eu cette pensée qui le fait rire encore aujourd’hui, mais qu’elle ait jailli si spontanément, à peine formée et déjà habillée de ces trois mots dont il garantit l’exactitude –le « chouette ! » compris. L’instant d’après, il a vu qu’au dessus des béquilles il y avait un visage avenant, un beau sourire, quelque chose d’ouvert, de joyeux et de grave qui faisait bien sûr partie de l’impression générale, mais ce qui est venu d’abord, avant l’impression générale, c’est les béquilles. Sa façon d’avancer vers lui sur ses béquilles : il a tout de suite pris ça comme un cadeau. Et il s’est tout de suite senti joyeux de pouvoir lui faire un cadeau en retour. C’était tout simple : il suffisait de se lever et de contourner le bureau pour lui montrer que, même s’il n’avait pas de béquille, il boitait lui aussi.
Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, Gallimard, « Folio », p. 205-206.
Et une petite pensée-cadeau pour ma Petite sœur qui est un peu plus grande aujourd’hui…
Portrait d’une rencontre, 1
Lundi 2 janvier 2012
Il est ici question du portrait de la rencontre de Patrice, l’idéaliste, et de Juliette, la juriste, belle-soeur du narrateur, Emmanuel Carrère. C’est le portrait de leurs différences, ce tout ce qui aurait dû les séparer, socialement, idéologiquement, familialement. Et de l’infirmité de Juliette, qui, au lieu de dresser une barrière physique entre eux, a été une des clés de construction de leur amour.
Quand Hélène me disait que Juliette était la plus jolie des trois sœurs et qu’elle en était jalouse, je secouais la tête. Je l’avais vue malade, je l’avais vue mourante, j’avais vu des photos d’enfance sur lesquelles, d’ailleurs, Hélène et elle se ressemblent énormément. Sur celles que m’a montrées Patrice, elle est en effet exceptionnellement jolie, avec une grande bouche sensuelle et pleine de dents, comme Julia Roberts ou Béatrice Dalle, et un sourire qui n’est pas seulement rayonnant, comme le disent tous ceux qui l’ont connue, mais vorace, presque carnassier. Sociable, drôle, à l’aise en société, elle avait un éclat qui aurait dû décourager un garçon comme Patrice. Heureusement, il y avait ses béquilles. Elles la rendaient accessible.
Il ne se sont pas vus tout de suite en tête-à-tête, leurs premières sorties ont eu lieu en groupe. Leur professeur les emmenait au théâtre, au théâtre il y a des escaliers à monter et Juliette ne pouvait pas les monter. Patrice est timide mais costaud. Dès la première fois, il a pris Juliette dans ses bras et personne ensuite ne lui a plus disputé ce privilège. Ils ont monté, l’un portant l’autre, tous les escaliers qui se présentaient à eux. Ils se sont mis à visiter des monuments, de préférence avec beaucoup d’étages, et, lorsqu’ils étaient assis l’un à côté de l’autre dans la pénombre des théâtres, à se tenir les mains. On était très sensibles des mains tous les deux, se rappelle Patrice. Leurs doigts s’effleuraient, se caressaient, s’enchevêtraient pendant des heures, ce n’était jamais pareil, toujours nouveau, toujours bouleversant. Il osait à peine croire que c’était à lui que ce miracle arrivait. Puis ils se sont embrassés. Puis ils ont fait l’amour. Il l’a déshabillée, elle a été nue dans ses bras, il a manipulé doucement ses jambes presque inertes. Pour tous les deux, c’était la première fois.
Patrice avait trouvé la princesse de ses rêves. Belle, intelligente, trop belle et trop intelligente pour lui, estimait-il, et pourtant avec elle tout était simple. Il n’y avait pas de coquetterie, pas de traîtrise, pas de coup fourrés à redouter. Il pouvait être lui-même sous son regard, s’abandonner sans craindre qu’elle n’abuse de sa naïveté. Ce qui leur arrivait était aussi sérieux pour elle que pour lui. Ils s’aimaient, ils allaient donc être mari et femme.
Leurs différences de caractère, au début, les ont tout de même inquiétés, surtout elle. Non seulement Patrice n’avait pas de vrai métier mais il ne se souciait pas d’en avoir. Gagner de quoi vivre en conduisant des camionnettes ou en animant un atelier de bande dessinée dans une centre de loisirs de la Ville de Paris lui suffisait. Juliette au contraire était déterminée, volontaire. Elle attachait une grande importance à ses études. Ça l’embêtait que Patrice soit si rêveur, si peu combatif, et ça embêtait Patrice qu’elle fasse du droit. À Assas, qui plus est, une faculté connue pour être un repaire de fachos. Sans être activement politisé, Patrice se disait anarchiste et ne voyait dans le droit qu’un instrument de répression au service des riches et des puissants. Si encore Juliette avait voulu être avocate, défendre la veuve et l’orphelin, il aurait pu comprendre, mais juge ! De fait, à un moment, Juliette avait pensé s’inscrire au barreau. Elle avait fait un magistère de droit des affaires, mais l’enseignement l’avait écœurée. On apprenait aux étudiants comment ruser pour permettre à leurs futurs clients de faire leurs profits à leur guise et leur extorquer de juteux honoraires. Ce libéralisme ouvertement assimilé à la loi du plus fort, le cynisme souriant de ses professeurs et de ses condisciples, tout cela donnait raison aux diatribes idéalistes de Patrice. Elle aimait le droit, lui expliquait-elle patiemment, parce qu’entre le faible et le puissant c’est la loi qui protège et la liberté qui asservit, et c’est pour faire respecter la loi au lieu de la détourner qu’elle voulait devenir magistrate. Patrice comprenait le principe mais tout de même, pour lui, avoir une femme juge, c’était difficile à avaler.
La différence de milieux était difficile à avaler aussi. Juliette habitait chez ses parents et chaque fois qu’il allait la retrouver dans leur grand appartement près de Denfert-Rochereau il était affreusement mal à l’aise. Tous deux scientifiques de haut niveau, Jacques et Marie-Aude sont catholiques, élitistes, plutôt à droite, et Patrice se sentait chez eux toisé de haut, lui et sa famille où l’on est provincial, professeur de collège ou institutrice, et où l’on roule dans de vieilles guimbardes constellées de stickers hostiles aux centrales nucléaires. Le dogme, chez les siens, c’est la discussion : on peut discuter de tout, on doit discuter de tout, de la discussion jaillit la lumière. Or, aux yeux des parents de Juliette, comme d’ailleurs des miens, il n’y a pas plus de discussion possible avec un écologiste savoyard qui pense que les fours à micro-ondes sont dangereux pour la santé qu’avec quelqu’un qui viendrait dire que la Terre est plate et que le Soleil lui tourne autour. Il n’y a pas là deux opinions également dignes d’être prises en considération, mais d’un côté des gens qui savent, de l’autre des gens qui ne savent pas, et on ne va pas faire semblant de s’affronter à armes égales. Il fallait reconnaître à Patrice qu’il était gentil, qu’il aimait sincèrement Juliette, mais il symbolisait tout ce qu’ils avaient en horreur : les cheveux longs, la niaiserie soixante-huitarde, par dessus tout l’échec. Ils le voyaient comme un raté et ne pouvaient se résoudre à ce que leur fille si douée s’éprenne d’un raté. Lui, de son côté, avait des objets d’hostilité abstraits et généraux : le grand capital, la religion considérée comme opium du peuple, la science devenue folle, mais il n’était pas dans son caractère d’étendre ces aversions de principe à des personnes particulières. Le mépris qu’il ressentait de la part de ses futurs beaux-parents le désarmait, il n’était pas capable de leur rendre, tout au plus de penser qu’il aurait mieux valu pour lui ne pas croiser leur route. Mais il l’avait croisée, il aimait Juliette, il fallait se débrouiller avec ça.
De ce mépris, je pense qu’elle a plus souffert que lui, parce qu’elle était bien la fille de ses parents et qu’elle n’a pas pu ne pas le voir avec les yeux de ses parents. Elle n’était pas du genre à se raconter d’histoires. C’est en toute lucidité qu’elle l’a choisi. Mais avant de le choisir elle a hésité. Elle a dû se représenter très précisément, dans une lumière crue et même cruelle, ce que ce serait de passer sa vie avec Patrice. Les limites dans lesquelles ce choix l’enfermait. Et, d’un autre côté, l’assise qu’il lui donnerait. La certitude d’être aimée totalement, d’être toujours portée.
Patrice lui-même en est venu à se poser des questions. Le droit, les beaux-parents, l’impératif de réussir, rien de tout cela n’était pour lui. Avec elle, il était trop loin de ses bases. Et puis, état-il raisonnable de faire sa vie avec une handicapée sans avoir jamais connu d’autre fille ? Il raconte qu’un jour ils en ont discuté, et conclu raisonnablement qu’ils n’étaient pas faits pour vivre ensemble. Ils se sont dit pourquoi. Patrice était le plus loquace, c’était toujours comme cela entre eux. Il disait ce qui lui passait par la tête et le cœur, se livrait sans réserve, tandis qu’elle, on ne savait jamais très bien ce qu’elle pensait. À l’issue de cette discussion, ils ont résolu de se séparer et se sont mis à pleurer. Ils sont restés deux heures à pleurer dans les bras l’un de l’autre, sur le lit à une place de la petite chambre de Cachan, et en pleurant chacun a compris qu’il n’existait aucun chagrin dont l’autre ne pourrait le consoler, que le seul chagrin inconsolable était précisément celui qu’ils s’infligeaient à ce moment. Alors ils ont dit que non, ils n’allaient pas se séparer, qu’ils allaient vivre ensemble, qu’ils ne se quitteraient jamais, et c’est exactement ce qu’ils ont fait.
Emmanuel Carrère, D’autres vies que la mienne, Gallimard, « Folio », p. 214-219.
Ricochets, 1
Mercredi 7 décembre 2011
Le narrateur habite chez Don Gaetano, le concierge, dans la loge du rez-de- chaussée d’un immeuble napolitain, dans l’immédiate après-guerre. De là, il épie une petite fille des étages, qu’il n’aperçoit jamais qu’à sa fenêtre. Depuis la cour où il joue au foot avec les autres garçons de l’immeuble, ou depuis sa chambrette, l’image d’Anna renvoyée par reflets est une obsession de l’enfant.
Une histoire de fenêtres, donc, qui a toute sa place ici.
Devant les buts à défendre s’étalait une mare, due à une fuite d’eau. Au début du jeu, elle était limpide, je pouvais y voir le reflet de la petite fille à la fenêtre, pendant que mon équipe attaquait. Je ne la croisais jamais, je ne savais pas comment était fait le reste de son corps, sous son visage appuyé sur ses mains. De ma petite fenêtre, les jours de soleil, j’arrivais à remonter vers elle à travers un ricochet de vitres. Je la regardais jusqu’à ce que la lumière me donne des larmes aux yeux. Les vitres fermées des fenêtres de la cour permettaient au reflet qui la contenait de parvenir à mon coin d’ombre. Combien de tours faisait son portrait pour atteindre ma petite fenêtre ? Un poste de télé était arrivé depuis peu dans un des appartements de l’immeuble. J’entendais dire qu’on y voyait bouger des gens et des animaux, mais sans couleurs. Moi, en revanche, je pouvais voir la petite fille avec tout le marron de ses cheveux, le vert de sa robe et le jaune qu’y mettait le soleil.
Erri de Luca, Le jour d’avant le bonheur, Gallimard, p. 12.
Traduction de Danièle Valin
Portrait
Lundi 5 décembre 2011
Humanité. Voilà ce qui ressort du portrait que Valérie Zenatti brosse de son compatriote Aharon Appelfeld. Un terme qui correspond aussi très bien au contenu de ses romans, qu’ils soient publiés en littérature jeunesse (Une bouteille dans la mer de Gaza, Quand j’étais soldate) ou chez l’Olivier, pour les « grands » (Les âmes sœurs, En retard pour la guerre). Mais aussi dans son œuvre de passeuse, de traductrice, dont il est question dans Mensonges.
Portrait d’Aharon Appelfeld, Israël, Jérusalem, maison d’Anna Tikho, 2004.
Bordant l’allée pavée, des géraniums, (si rares dans ce pays), quelques pins, quelques cyprès, des rosiers. Devant moi, un homme armé, chargé de la sécurité (comme il y en a tant dans ce pays). Il me demande quel est le but de ma venue. Je réponds « j’ai rendez-vous avec Aharon Appelfeld ». Il hoche la tête et fouille mollement mon sac, pour la forme. Le nom que j’ai prononcé a ici valeur de mot de passe.
La terrasse du café est ouverte, le printemps est doux à Jérusalem, même si les nuits sont encore fraîches.
Un peu à l’écart, une tasse de thé posée devant lui, il est en train de relire et corriger un texte.
De lui, je connais la voix infiniment douce et profonde entendue deux ou trois fois au téléphone. Je connais aussi de la façon la plus intime qui soit deux de ses livres, qui vont être publiés en France : Histoire d’une vie et L’Amour, soudain.
Aharon.
J’aime le souffle léger du « hé » de son prénom en hébreu, que le « h » français, muet, ne rend pas.
Aharon est dans la Bible le frère de Moïse, qui ne pouvait parler autrement qu’en bégayant, et avait donc demandé à son frère de prendre la parole à sa place devant Pharaon.
J’admire profondément cet auteur de la Bible qui osa attribuer au plus grand prophète un « défaut », une faille, une faiblesse, celle de l’oralité, justement.
Je demande à une serveuse de l’avertir de ma présence. Elle lui chuchote quelques mots à l’oreille, il lève la tête, son regard me cherche, s’éclaire, il se lève d’un bond, s’empresse vers moi, prend mes mains dans les siennes -le contact de ses mains douces, enveloppantes, paternelles-, m’embrasse et m’indique avec chaleur la chaise en face de lui.
J’ai trente-quatre ans, je suis mère de deux enfants, dix ans plus tôt j’ai passé dix minutes en tête à tête avec François Mitterrand sans être trop intimidée, j’ai connu à ma manière quelques guerres, mais à cet instant, je suis une femme à la voix mal assurée, qui malaxe et frotte ses mains l’une contre l’autre sous la table, et ne sait que dire parce que c’est la première fois qu’elle se trouve face à l’homme qui l’impressionne le plus au monde.
Son héros.
Un héros pas comme les autres, car les héros ont ceci d’extraordinaire qu’ils ne ressemblent jamais à l’idée que l’on se fait des supposés petits-cousins de Robin des Bois, Zorro ou Superman.
C’est un petit homme de soixante-douze ans au regard tour à tour bleu pâle, vert tendre, bleu vif, vert triste, bleu malice. Un homme qui a connu toute la palette de ce que peut vivre un être, dans ses plus infimes nuances, du meilleur au pire.
Comme tout vrai héros, il s’intéresse aux autres et avant toute chose il s’enquiert de ce que je veux manger et boire, je sens que c’est important pour lui. Je commande une citronnade et un gâteau au fromage blanc, « un gâteau au fromage blanc réjouit toujours », dit-il. Il sourit et me regarde avec bienveillance, pose des questions dont il écoute les réponses avec une attention qui ne faiblira pas, marquant parfois son étonnement en hochant la tête ou en écarquillant les yeux, posant une autre question sur un point précis.
Où es-tu née ?
Où sont nés tes parents ?
Où as-tu appris à parler si bien hébreu ?
On m’a dit que tu écrivais toi aussi. Qu’écris-tu ?
Pourquoi as-tu eu envie de traduire ces livres ?
Alors, un à un, des pans entiers de ma vie surgissent presque malgré moi, entre les cyprès, les rosiers et les géraniums de la maison d’Anna Tikho. Je respire un peu mieux à chaque question, j’ose en poser moi aussi, l’échange devient conversation et, de l’extérieur, nous sommes un vieil homme au regard vif et une jeune femme que l’on pourrait prendre pour un grand-père et sa petite-fille ou pour un écrivain israélien et une journaliste venue l’interviewer, ou même, en tendant l’oreille, pour un écrivain et sa traductrice en langue française. En réalité, il se passe là quelque chose que personne ne peut distinguer à part lui, peut-être, et moi, plus tard, car les mots et la prise de conscience qui les accompagne viennent toujours à contre-coup des émotions et des sensations. Il n’y a pas de vieil homme, pas de jeune femme, cette image est un leurre et recouvre un autre tableau, plus juste, plus vrai, invisible comme la vérité nue des enfants perdus dans les bois.
Valérie Zenatti, Mensonges, Éditions de l’Olivier, « Figures libres », 2011, p. 52-56
Fougère, 3
Lundi 17 octobre 2011
La mère, encore. Souvenir d’un cliché symbolisant la douleur du sentiment de ne pas exister, photo de la femme en amoureuse brûlante et passionnée de Char plus que de la mère. Un bonheur dont l’enfant se sent exclue, absente qu’elle est dans le cadre.
Cette photo est comme le négatif de ce que je vivais alors. Maman partait, maman était une fougère, une herbe folle, qui se penchait sur moi, mais qu’un vent sauvage m’enlevait aussitôt. Une fleur qui pouvait s’assécher dès que cueillie. Il ne fallait pas la cueillir. Alors, peut-être, elle reviendrait. Il fallait la laisser partir. On n’avait pas le choix. Mais le ventre se tordait de douleur et les larmes serraient la gorge et l’esprit se perdait. Où était maman ? Qui était-elle ? Cette double, cette sulfureuse, cette aimée ? Cette disparue.
(…)
Après qui courais-je dans mes rêves, dans mes nuits d’enfant sans sommeil ?
Ma mère nous échappait et c’était mon père dont je redoutais la disparition. Mon père dont je craignais qu’il se transforme en quelque créature étrange, qu’il perde son humanité, sa « paternité », que sa présence bienfaisante ne soit un mirage.
J’avais toujours en moi cette double vision des autres, de ceux que j’aimais. Je savais qu’ils n’étaient pas un. Je pressentais que, derrière le masque de « papa », il y avait un démon ou un vampire, derrière celui de « maman », quelqu’un d’autre. Je disais « une fée ». Je la croyais réellement surnaturelle et, l’année de l’apprentissage de la lecture, j’aurais été prête à pourfendre quiconque se serait permis d’en douter. Maman était « une fée ». Je ne croyais pas aux fées en général, mais maman en était une. La seule.
Paule du Bouchet, Emportée : récit, Actes Sud, p. 72-73, p.76
Prévert
Jeudi 19 mai 2011
Gros retard de mise en ligne de cette dernière quinzaine, la faute à un calendrier professionnel un peu bouleversé et très rempli…. Une publication impromptue du jeudi, donc, pour rattraper le temps perdu.
Ma récente rencontre avec la délicieuse Jacqueline Duhême m’a fait prendre conscience de l’absence de Prévert dans cette liste de textes… Oubli rattrapé, avec ce poème qui a un goût de CP et de peinture à l’encre, avec des souvenirs très nets d’odeurs, de couleurs et de mots associés au plus beau cahier de poésie que j’aie jamais eu à l’école.
Pour faire le portrait d’un oiseau
Peindre d’abord une cage
avec une porte ouverte
peindre ensuite
quelque chose de joli
quelque chose de simple
quelque chose de beau
quelque chose d’utile
pour l’oiseau
placer ensuite la toile contre un arbre
dans un jardin
dans un bois
ou dans une forêt
se cacher derrière l’arbre
sans rien dire
sans bouger…
Parfois l’oiseau arrive vite
mais il peut aussi mettre de longues années
avant de se décider
Ne pas se décourager
attendre
attendre s’il le faut pendant des années
la vitesse ou la lenteur de l’arrivée de l’oiseau
n’ayant aucun rapport
avec la réussite du tableau
Quand l’oiseau arrive
s’il arrive
observer le plus profond silence
attendre que l’oiseau entre dans la cage
et quand il est entré
fermer doucement la porte avec le pinceau
puis
effacer un à un tous les barreaux
en ayant soin de ne toucher aucune des plumes de l’oiseau
Faire ensuite le portrait de l’arbre
en choisissant la plus belle de ses branches
pour l’oiseau
peindre aussi le vert feuillage et la fraîcheur du vent
la poussière du soleil
et le bruit des bêtes de l’herbe dans la chaleur de l’été
et puis attendre que l’oiseau se décide à chanter
Si l’oiseau ne chante pas
C’est mauvais signe
signe que le tableau est mauvais
mais s’il chante c’est bon signe
signe que vous pouvez signer
Alors vous arrachez tout doucement
une des plumes de l’oiseau
et vous écrivez votre nom dans un coin du tableau.
Jacques Prévert
Vango Romano
Lundi 21 mars
Pour célébrer tout à la fois le printemps, une nouvelle année et la chance que j’ai de baigner tous les jours, le temps d’un stage, dans la littérature de jeunesse (que je me suis remise à dévorer allégrement), voici un court portrait d’enfant. Vango Romano, dont on suit avec délice les aventures autour du monde dans le roman éponyme, est mystérieusement élevé à l’écart du monde sur les pentes du Stromboli, dans les îles Éoliennes.
« Vango poussa sur la pente de ce volcan éteint.
Il y trouva tout ce dont il avait besoin.
Il grandit avec trois nourrices : la liberté, la solitude et Mademoiselle. A elles trois, elles firent son éducation. Il reçut d’elles tout ce qu’il croyait possible d’apprendre.
A cinq ans, il comprenait cinq langues mais ne parlait à personne. A sept ans, il grimpait les falaises sans avoir besoin des pieds. A neuf ans, il nourrissait les faucons qui plongeaient sur lui pour manger dans sa main. Il dormait torse nu sur les rochers avec un lézard sur le cœur. Il appelait les hirondelles en sifflant. Il lisait des romans français que sa nourrice achetait à Lipari. Il montait en haut du volcan pour se mouiller les cheveux dans les nuages. Il chantait des berceuses russes aux scarabées. Il regardait Mademoiselle couper les légumes avec des facettes impeccables, comme on taille des diamants. Puis il dévorait sa cuisine de fée. »
Timothée de Fombelle, Vango : Entre ciel et terre (tome 1), Gallimard jeunesse
Encore quelques jours de pause…
Vendredi 28 janvier 2011
… en guise de répit pour cette fin de période mouvementée et pour faire la transition avec le retour à la vraie vie (balades parisiennes et lectures en perspective). Ensuite, promis, je réfléchis sérieusement à une suite disons… hebdomadaire, ou bimensuelle, pour cet Inventaire, avec une forme sans doute appelée à évoluer.
« Arrêt du permanent », ou souvenir de Georges Segal, les petites salles d’art et d’essais sont souvent pleines de trésors.
Cinéma, Saint Germain des Prés (Paris, août 2010)
Monologue
Mercredi 29 décembre
Le long monologue de Lorenzo, la nuit, avant le meurtre, sous la lune. Je ne connais cette pièce que comme du Théâtre dans un fauteuil, je ne l’ai jamais vue jouée. Mais si au départ j’étais plutôt fermée à ce texte, j’ai pris goût à l’entendre lire, et j’aime particulièrement ce passage, ce portrait de Lorenzo.
Acte IV, scène 9
Une place; il est nuit.
LORENZO, entrant.
Je lui dirai que c’est un motif de pudeur, et j’emporterai la lumière ; – cela se fait tous les jours; – une nouvelle mariée, par exemple, exige cela de son mari pour entrer dans la chambre nuptiale ; et Catherine passe pour très vertueuse. – Pauvre fille ! qui l’est sous le soleil, si elle ne l’est pas ! Que ma mère mourût de tout cela, voilà ce qui pourrait arriver. Ainsi donc, voilà qui est fait. Patience ! une heure est une heure, et l’horloge vient de sonner ; si vous y tenez cependant ! – Mais non, pourquoi ? Emporte le flambeau si tu veux ; la première fois qu’une femme se donne, cela est tout simple. – Entrez donc, chauffez-vous donc un peu. – Oh ! mon Dieu, oui, pur caprice de jeune fille ; et quel motif de croire à ce meurtre ? Cela pourra les étonner, même Philippe. Te voilà, toi, face livide ? (La lune paraît.) Si les républicains étaient des hommes, quelle révolution demain dans la ville ! Mais Pierre est un ambitieux ; les Ruccellaï seuls valent quelque chose. – Ah ! les mots, les mots, les éternelles paroles ! s’il y a quelqu’un là-haut, il doit bien rire de nous tous ; cela est très comique, très comique, vraiment. – ô bavardage humain! ô grand tueur de corps morts ! grand défonceur de portes ouvertes ! ô hommes sans bras ! Non ! non ! je n’emporterai pas la lumière. – J’irai droit au cœur ; il se verra tuer… sang du Christ ! on se mettra demain aux fenêtres. Pourvu qu’il n’ait pas imaginé quelque cuirasse nouvelle, quelque cotte de mailles ! Maudite invention ! Lutter avec Dieu et le diable, ce n’est rien; mais lutter avec des bouts de ferraille croisés les uns sur les autres par la main sale d’un armurier ! Je passerai le second pour entrer; il posera son épée, là, – ou là, – oui, sur le canapé. – Quant à l’affaire du baudrier à rouler autour de la garde, cela est aisé ; s’il pouvait lui prendre fantaisie de se coucher, voilà où serait le vrai moyen ; couché, assis, ou debout ? assis plutôt. Je commencerai par sortir; Scoronconcolo est enfermé dans le cabinet. Alors nous venons, nous venons ; je ne voudrais pourtant pas qu’il tournât le dos. j’irai à lui tout droit. – Allons, la paix, la paix ! l’heure va venir. – Il faut que j’aille dans quelque cabaret ; je ne m’aperçois pas que je prends du froid, et je boirai une bouteille ; – non, je ne veux pas boire. Où diable vais-je donc? les cabarets sont fermés. Est-elle bonne fille ? – Oui, vraiment. – En chemise? Oh ! non, non, je ne le pense pas. – Pauvre Catherine ! que ma mère mourût de tout cela, ce serait triste. Et quand je lui aurais dit mon projet, qu’aurais-je pu y faire ? au lieu de la consoler, cela lui aurait fait dire : crime ! crime ! jusqu’à son dernier soupir ! je ne sais pourquoi je marche, je tombe de lassitude. (il s’assoit sur un banc.) Pauvre Philippe ! une fille belle comme le jour ; Une seule fois, je me suis assis près d’elle sous le marronnier ; ces petites mains blanches, comme cela travaillait ! Que de journées j’ai passées, toi, assis sous les arbres ! Ah ! quelle tranquillité! qui horizon à Cafaggiuolo! Jeannette était jolie, la petite fille du concierge, en faisant sécher sa lessive. Comme elle chassait les chèvres qui venaient marcher sur son linge étendu sur le gazon ! la chèvre blanche revenait toujours avec ses grandes pattes menues. (Une horloge sonne.) Ah ! ah ! il faut que j’aille là-bas. – Bonsoir, mignon ; eh ! trinque donc avec Giomo. – Bon vin! cela serait plaisant qu’il lui vînt à l’idée de me dire : Ta chambre est-elle retirée ? entendra-t-on quelque chose du voisinage ? Cela serait plaisant ; ah! on y a pourvu. Oui, cela serait drôle qu’il lui vint cette idée. Je me trompe d’heure ; ce n’est que la demie. Quelle est donc cette lumière sous le portique de l’église ? on taille, on remue des pierres. Il paraît que ces hommes sont courageux avec les pierres. Comme ils coupent ! comme ils enfoncent ! Ils font un crucifix ; avec quel courage ils le clouent! je voudrais voir que leur cadavre de marbre les prît tout d’un coup à la gorge. Eh bien? eh bien ? quoi donc ? j’ai des envies de danser qui sont incroyables. je crois, si je m’y laissais aller, que je sauterais comme un moineau sur tous ces gros plâtras et sur toutes ces poutres. Eh, mignon ! eh, mignon ! mettez vos gants neufs, un plus bel habit que cela, tra la la ! faites-vous beau, la mariée est belle. Mais, je vous le dis à l’oreille, prenez garde à son petit couteau. (Il sort en courant.)
Alfred de Musset, Lorenzaccio, 1834
Portrait de Markus M.
Mardi 28 décembre
Dans Déloger l’animal, comme dans tous les romans de Véronique Ovaldé, il y a des choses qui tournent rond, et d’autres pas, et qui laissent la porte ouverte au merveilleux.
Ici, la narratrice ne sait rien de son père, ne sait pas que c’est celui qui la berce, vit avec elle, partage la vie de sa mère et qu’elle appelle Monsieur Loyal. Elle soupçonne des non-dits dans le passé de sa mère, essaie d’expliquer son étrange disparition. Elle imagine le portrait de ce garçon qu’elle baptise Markus M., qui aurait aimé sa mère, que sa mère aurait aimé, et qui viendrait des montagnes.
« Je peux penser à lui et il m’apparaît sale et beau et tendre comme quelque chose qui sortirait d’une huche à pain, comme quelque chose qui serait précieux, qu’on aurait déposé dans la sciure pour ne pas le casser. Je pense à Markus M. dorénavant quand je me sens isolée dans un grand froid neigeux, quand j’ai et donne l’impression d’avoir sept ans alors que j’en ai plus du double. J’aime imaginer l’histoire de Markus M. et de ma mère.
Cela a trait à l’enfance de ma mère mais que puis-je faire de l’enfance de ma mère, que puis-je même oser connaître de ce mystère. L’enfance de mon père me semble plus imaginable parce que tout à fait romanesque. Je peux y mettre ce que je veux, ordonner les événements et les pensées comme je l’entends, gratouiller pour chercher des preuves et des explications, colmater les brèches pour que mon sous-marin ne sombre pas, je peux lui inventer une enfance, et un ruban de pensées, personne ne peut m’en empêcher. »
Véronique Ovaldé, Déloger l’animal (II, 14, p. 77, édition Actes Sud)
Orbes
Samedi 18 décembre
Un poème qui me suit depuis longtemps, longtemps déjà … En fait, un des premiers que je me rappelle avoir CHOISI (c’est-à-dire, pas pour l’école) et recopié.
La courbe de tes yeux
La courbe de tes yeux fait le tour de mon cœur,
Un rond de danse et de douceur,
Auréole du temps, berceau nocturne et sûr,
Et si je ne sais plus tout ce que j’ai vécu
C’est que tes yeux ne m’ont pas toujours vu.
Feuilles de jour et mousse de rosée,
Roseaux du vent, sourires parfumés,
Ailes couvrant le monde de lumière,
Bateaux chargés du ciel et de la mer,
Chasseurs des bruits et sources des couleurs,
Parfums éclos d’une couvée d’aurores
Qui gît toujours sur la paille des astres,
Comme le jour dépend de l’innocence
Le monde entier dépend de tes yeux purs
Et tout mon sang coule dans leurs regards.
Paul Eluard, « La courbe de tes yeux », Capitale de la douleur (1926)
Jardin en hiver
Mardi 14 décembre
Bérénice, 3
Jeudi 9 décembre
Encore quelques mots de la Bérénice d’Aragon, celle qui ressemble à l’Inconnue de la Seine dont Aurélien possède le visage de plâtre.
« Aurélien croque des chips. Il dit très sérieusement : « Zamora a voulu vous voler votre secret… celui qui vous fait si différente quand vos yeux sont ouverts et quand ils sont fermés… mais voilà, ce secret-là n’est pas pour lui…
– Pour qui est-il ?
– C’est que je voudrais savoir. »
Elle ne répondit pas et ferma les yeux. Il la regardait : « Voilà… voilà… -murmura-t-il.- Le mystère s’opère, Bérénice… Tout le monde au monde peut vous voir ainsi, sauf vous. Sauf vous. Vous êtes alors sans défense. Vous avouez quelque chose que vous teniez caché. C’est la secrète Bérénice… Non, ne rouvrez pas vos beaux yeux noirs… Restez comme cela, livrée… Vous me disiez en venant que je ne vous connais pas… Je ne connais pas l’autre… celle qui a les yeux ouverts… mais celle-ci, la Bérénice aux yeux clos, comme je la connais ! Et depuis longtemps… Ne souriez pas… C’est l’autre qui sourit ainsi… Pas la mienne, ma Bérénice… parce que son sourire à elle… Vous ne me croyez pas ? Vous viendrez chez moi, et je vous montrerai son sourire. »
p. 252 (édition Gallimard, « Folio »)
Un peu plus loin, Bérénice ayant cassé le moulage de l’Inconnue lors de sa visite à Aurélien, elle lui dépose un paquet contenant le moulage e son propre visage :
« Au premier coup d’oeil il ne comprit pas. Il tenait le masque comme une chose connue, sans le mettre d’aplomb, n’importe comment. Puis, il eut le sentiment étrange que l’Inconnue avait bougé, je veux dire qu’il avait de l’Inconnue comme un instantané bougé, c’était et ce n’était pas le moulage qu’il connaissait si bien. IL eut le sentiment vague de ce que cela signifiait. Il retourna le maque, tenu à deux mains. Il le regarda bien.
Non, ce n’était pas l’Inconnue. On avait cherché, on avait manifestement cherché à rappeler sa coiffure, le découpage du masque, mais c’étaient d’autres traits, la bouche surtout… Bérénice, c’était Bérénice ! Il ne pouvait pas en douter, bien que cette image mortuaire, cette image de plâtre lui apparût comme une Bérénice passée à travers les mystères d’un métamorphose. Si semblable et si dissemblable. Il voyait maintenant combien elle était différente de l’Inconnue, pourquoi il n’avait d’abord pont aperçu la parenté de ces deux visages, pourquoi il avait fallu que d’autres la lui fissent apercevoir. Alors il connaissait trop bien l’Inconnue, lui, et pas assez Bérénice. Les autres n’avaient des deux visages qu’une sensation passagère, suffisante pour s’y tromper, trop superficielle pour apercevoir des différences profondes comme les abîmes du cœur. On ne pouvait pas tromper Aurélien.
Son cœur battait. Il se souvint de la scène où le masque de l’Inconnue était tombé à terre, s’était brisé. Il revoyait le plâtre sur le tapis. Il éprouva la fragilité de cette chose dans ses mains. Il eut peur de la laisser échapper dans son émotion qui le faisait trembler. Il posa sur le lit le visage de Bérénice. Cela lui fit drôle. Il l’avait posé un peu au hasard. IL le reprit, et doucement, comme un criminel il le porta jusqu’à l’oreiller, jusqu’à la place que soulevait le bombé de l’oreiller, sur la soie sombre. Et debout, silencieux, immobile, il regarda longuement Bérénice.
Bérénice aux yeux fermés.
Elle s’était prêtée pour lui à ce jeu tragique. Elle avait été chez le modeleur, elle s’était étendue les yeux fermés… Elle avait eu le plâtre sur les yeux, sur la bouche, sur les narines, à la naissance des cheveux, aux oreilles… Le plâtre partout comme la pâleur de la mort. Sous le plâtre humide qui prenait la matrice de ses traits, elle avait continué de respirer, d’un souffle retenu, elle pensait à lui, elle acceptait pour lui ce désagréable sentiment que doit donner ce travail funèbre… Elle confiait à ce miroir creux et froid la forme périssable d’elle-même. Elle confiait ce message, cet aveu, au plâtre qui séchait ses lèvres, ses lèvres avaient formé, au toucher du plâtre, l’aveu informulé, le baiser quelle n’avait pas donné de ses lèvres vivantes, la matrice de ce baiser. Aurélien regardait avec trouble la moue douloureuse de ces lèvres aux cent petites fentes délicates, ce modèle de pétale, cette expression de désespoir. Ces lèvres qui criaient le désir bafoué, la soif inassouvie. Oh, qu’elle était plus belle que l’Inconnue, qu’elle était plus terrible, plus terriblement Inconnue, Bérénice vivante et morte, absente et présente, enfin vraie ! »
p. 387-388 (édition Gallimard, « Folio »)
Louis Aragon, Bérénice
Bérénice, 2
Mercredi 8 décembre
Évidemment, quand on dit Bérénice, on pense Aurélien. Sans doute Bérénice a-t-elle quelque chose de cette chevelure brune (bien que le texte la dise blonde) et de cette voix grave de Romane Borhinger dans l’adaptation d’Arnaud Selignac. Elle a surtout le charme envoûtant que lui prête Aragon par la voix d’Aurélien.
C’est ici le célèbre incipit du roman, légèrement coupé, auquel j’ai ajouté un autre élément du portrait de Bérénice, quelques pages plus loin.
« La première fois qu’Aurélien vit Bérénice, il la trouva franchement laide. Elle lui déplut, enfin. Il n’aima pas comment elle était habillée. Une étoffe qu’il n’aurait pas choisie. Il avait des idées sur les étoffes. Une étoffe qu’il avait vue sur plusieurs femmes. Cela lui fit mal augurer de celle-ci qui portait un nom de princesse d’Orient sans avoir l’air de se considérer dans l’obligation d’avoir du goût. Ses cheveux étaient ternes ce jour-là, mal tenus. Les cheveux coupés, ça demande des soins constants. Aurélien n’aurait pas pu dire si elle était blonde ou brune. Il l’avait mal regardée. Il lui en demeurait une impression vague, générale, d’ennui et d’irritation. Il se demanda même pourquoi. C’était disproportionné. Plutôt petite, pâle, je crois… Qu’elle se fût appelée Jeanne ou Marie, il n’y aurait pas repensé, après coup. Mais Bérénice. Drôle de superstition. Voilà bien ce qui l’irritait.
Il y avait un vers de Racine que ça lui remettait dans la tête, un vers qui l’avait hanté pendant la guerre, dans les tranchées, et plus tard démobilisé. Un vers qu’il ne trouvait même pas un beau vers, ou enfin dont la beauté lui semblait douteuse, inexplicable, mais qui l’avait obsédé, qui l’obsédait encore :
Je demeurai longtemps errant dans Césarée…
En général, les vers, lui… Mais celui-ci lui revenait et revenait. Pourquoi ? c’est ce qu’il ne s’expliquait pas. Tout à fait indépendamment de l’histoire de Bérénice… l’autre, la vraie… D’ailleurs il ne se rappelait que dans ses grandes lignes cette romance, cette scie. Brune alors, la Bérénice de la tragédie. Césarée, c’est du côté d’Antioche, de Beyrouth. Territoire sous mandat. Assez moricaude, même, des bracelets en veux-tu en voilà, et des tas de chichis, de voiles. Césarée… un beau nom pour une ville. Ou pour une femme. Un beau nom en tout cas. Césarée… Je demeurai longtemps je deviens gâteux. Impossible de se souvenir : comment s’appelait-il, le type qui disait ça, une espèce de grand bougre ravagé, mélancolique, fl…emmard, avec des yeux de charbon, la malaria… qui avait attendu pour se déclarer que Bérénice fût sur le point de se mettre en ménage, à Rome, avec un bellâtre potelé, ayant l’air d’un marchand de tissus qui fait l’article, à la manière dont il portait la toge. Tite. Sans rire. Tite.
Je demeurai longtemps errant dans Césarée…
Ça devait être une ville aux voies larges, très vide et silencieuse. Une ville frappée d’un malheur. Quelque chose comme une défaite. Désertée. Une ville pour les hommes de trente ans qui n’ont plus de cœur à rien. Une ville de pierre à parcourir la nuit sans croire à l’aube. Aurélien voyait des chiens s’enfuir derrière les colonnes, surpris à dépecer une charogne. Des épées abandonnées, des armures. Les restes d’un combat sans honneur.
(…)
Il passa ses doigts longs dans ses cheveux frisés, comme un peigne. Il pensait aux statues qu’il y a sur les places de Césarée : ces Dianes chasseresses, rien que des dianes chasseresses à l’air hagard.
Et des mendiants endormis à leurs pieds. »
p. 27-28, 31 (édition Gallimard, « Folio »)
(…)
« La seule chose qu’il aima d’elle tout de suite, ce fut la voix. Une voix de contralto chaude, profonde, nocturne. Aussi mystérieuse que les yeux de biche sous cette chevelure d’institutrice. Bérénice parlait avec une certaine lenteur. Avec de brusques emballements, vite réprimés qu’accompagnaient des lueurs dans les yeux comme des feux d’onyx. Puis soudain, il semblait, très vite, que la jeune femme eût le sentiment de s’être trahie, les coins de sa bouche s’abaissaient, les lèvres devenaient tremblantes, enfin tout cela s’achevait par un sourire, et la phrase commencée s’interrompait, laissant à un geste gauche de la main le soin de terminer une pensée audacieuse, dont tout dans ce maintien s’excusait maintenant. C’est alors qu’on voyait se baisser les paupières mauves, et si fines qu’on craignait vraiment qu’elle ne se déchirassent.
Il faut dire encore que Bérénice avait un mouvement des épaules comme pour empêcher de glisser un châle, qui la tirait généralement d’affaire quand elle ne voulait pas poursuivre une conversation, ou qu’elle voulait en changer le cours.»
p. 33 (édition Gallimard, « Folio »)
Louis Aragon, Bérénice